Depuis une vingtaine d’années, la Chine s’est imposée comme le partenaire incontournable des pays africains, bouleversant l’équilibre historique dominé par les puissances occidentales. Cette nouvelle donne se caractérise par une expansion sans précédent des relations sino-africaines, avec des investissements massifs dans les infrastructures et un engagement diplomatique soutenu de Pékin. Le plan stratégique de Xi Jinping pour l’Afrique révèle une vision à long terme, cherchant à consolider l’influence chinoise sur le continent alors même que les États-Unis et l’Europe semblent se désengager progressivement.
L’expansion chinoise en Afrique : un engagement stratégique sans précédent
L’évolution des relations sino-africaines au cours des 25 dernières années
Les relations entre la Chine et l’Afrique ont connu une métamorphose radicale depuis la fin des années 1990. Le continent africain est progressivement devenu une priorité pour Pékin, avec une intensification des échanges commerciaux et une multiplication des grands projets d’investissement chinois qui transforment le paysage économique africain.
La montée en puissance de la Chine sur le continent s’est confirmée en 2009 lorsqu’elle a détrôné les États-Unis comme premier partenaire commercial de l’Afrique. Cette date marque un tournant dans l’influence géopolitique en Afrique. Depuis lors, l’engagement chinois s’est diversifié, passant d’une approche essentiellement commerciale à un partenariat global incluant des aspects politiques, culturels et sécuritaires pour consolider la présence chinoise.
Le Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC): pierre angulaire de la diplomatie chinoise
Établi en 2000, le FOCAC représente l’instrument principal par lequel la Chine structure son dialogue avec les pays africains. Cette plateforme permet à Pékin d’annoncer ses engagements financiers et d’articuler sa vision stratégique pour le continent.
Le dernier sommet du FOCAC en septembre 2024 a marqué un tournant, avec Xi Jinping promettant plus de 50 milliards de dollars d’aide financière à l’Afrique pour les trois prochaines années. Ce montant comprend 30 milliards de dollars de lignes de crédit et 10 milliards d’investissements par des entreprises chinoises, ciblant principalement le commerce, l’agriculture et les infrastructures qui restent au cœur de la politique africaine de Pékin.
L’Initiative « Belt & Road » : intégration de l’Afrique dans la vision globale chinoise
L’Initiative « Belt & Road » (appelé BRI), que les francophones aiment appeler la « Nouvelle Route de la Soie » lancée par Xi Jinping en 2013, représente un élément central de la présence chinoise en Afrique. Elle intègre le continent dans la stratégie d’expansion économique mondiale que Pékin déploie avec détermination depuis une décennie.
Depuis son lancement, l’engagement cumulé de la Chine dans le cadre de la BRI en Afrique a atteint près de 170 milliards de dollars, avec une concentration notable dans les infrastructures de transport, l’énergie et l’exploitation minière. En 2024, l’Afrique représente désormais le deuxième continent bénéficiaire de ces investissements avec 29,2 milliards de dollars, juste derrière le Moyen-Orient qui domine actuellement les priorités géographiques de la BRI.
Le retrait occidental de l’Afrique : un désengagement progressif créant un vide stratégique
Le désengagement progressif des puissances occidentales s’observe à travers la réduction de l’aide au développement, le retrait militaire du Sahel, et la diminution des investissements directs dans plusieurs pays africains. Ce phénomène s’inscrit dans un contexte plus large, que l’on peut analyser à travers la doctrine d’hégémonie américaine et du déclin de l’influence européenne sur la scène mondiale.
Le désengagement occidental en Afrique prend plusieurs formes, reflétant une évolution des priorités stratégiques et des modèles d’engagement.
- Réduction de l’aide au développement, avec des coupes budgétaires affectant des secteurs clés comme la santé, l’éducation et l’agriculture.
- Retrait militaire de certaines régions, notamment au Sahel, laissant un vide sécuritaire que d’autres acteurs cherchent à combler.
- Diminution des investissements directs dans plusieurs pays africains, signalant un moindre intérêt économique de la part de certaines puissances occidentales.
- Réorientation des priorités stratégiques vers d’autres régions du monde, notamment l’Asie-Pacifique, au détriment de l’Afrique.
- Remise en question des modèles traditionnels d’aide au développement, avec une préférence pour des approches plus ciblées et conditionnelles.
En conséquence de ces différents facteurs, le continent africain doit s’adapter à une nouvelle donne géopolitique.
Selon des modélisations récentes, les réductions de l’aide américaine pourraient pousser 5,7 millions d’Africains supplémentaires dans l’extrême pauvreté l’année prochaine et jusqu’à 19 millions d’ici 2030. Cette tendance s’inscrit dans un contexte de réorientation des priorités stratégiques américaines vers l’Asie-Pacifique et de remise en question des modèles traditionnels d’aide au développement.
La vision stratégique de Xi Jinping pour l’Afrique : une approche multidimensionnelle
L’approche chinoise en matière d’investissement et d’infrastructure
La stratégie de Xi Jinping s’appuie sur des investissements massifs dans les infrastructures africaines. Cette approche constitue un socle pour le développement économique tout en renforçant l’influence chinoise et en sécurisant l’accès aux matières premières stratégiques du continent.
Contrairement aux bailleurs occidentaux traditionnels, la Chine propose des financements sans conditionnalités politiques, privilégiant une approche pragmatique centrée sur la réalisation rapide de projets visibles. La Chine a construit des infrastructures massives et soutenu les secteurs pétrolier et minier en Afrique en échange d’accords commerciaux, intégrant de nombreux projets africains dans l’initiative des Nouvelles Routes de la Soie. Cette politique du « gagnant-gagnant » se matérialise par la construction d’infrastructures.
La coopération économique et commerciale : au-delà des ressources naturelles
Si l’accès aux matières premières africaines demeure central dans la stratégie chinoise, la vision de Xi Jinping vise également à élargir le champ de la coopération économique à des secteurs à plus forte valeur ajoutée comme la technologie, l’agriculture moderne et les énergies renouvelables.
Les échanges commerciaux sino-africains ont atteint 282 milliards de dollars en 2023, avec un déséquilibre constant en faveur de la Chine. Pour remédier à cette asymétrie, Pékin a récemment annoncé des mesures visant à accroître les importations de produits agricoles africains et à soutenir l’industrialisation locale par le transfert de technologies.
Les dimensions sécuritaires et d’influence de l’engagement chinois
La coopération militaire et sécuritaire : une présence croissante
L’engagement militaire chinois en Afrique s’est considérablement renforcé ces dernières années, avec l’établissement d’une base navale à Djibouti en 2017, l’intensification des ventes d’armes et d’équipements militaires, et la formation croissante d’officiers africains par l’Armée populaire de libération.
Les exportations d’armements chinois vers l’Afrique offrent une option intéressante aux équipements occidentaux, étant généralement moins coûteuses et dépourvues de conditionnalités politiques. Cette présence croissante dans le domaine sécuritaire permet à la Chine de se positionner comme un acteur incontournable dans la résolution des crises régionales, notamment au Sahel et dans la Corne de l’Afrique.
Soft power et influence diplomatique : construire une communauté d’avenir partagé
Le concept de « communauté d’avenir partagé Chine-Afrique » développé par Xi Jinping représente la vision à long terme des relations sino-africaines, englobant coopération politique, développement économique et échanges culturels.
La Chine déploie un arsenal d’outils de soft power en Afrique, incluant la multiplication des Instituts Confucius (plus de 60 sur le continent), l’octroi de milliers de bourses d’études pour les étudiants africains, l’expansion des médias d’État chinois en langues locales, et le financement de projets symboliques comme le siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba ou celui de la CEDEAO à Abuja.
Les réactions africaines face à l’influence chinoise croissante
Perception par le leadership africain : entre opportunité stratégique et méfiance
Les dirigeants africains perçoivent généralement l’engagement chinois comme une opportunité de diversifier leurs partenariats internationaux et d’accélérer leur développement économique. Cette alliance stratégique renforce aussi leur marge de manœuvre face aux anciennes puissances coloniales occidentales, pour lesquelles les dirigeants africains et plus largement les populations africaines, ont développer une profonde rancoeur.
Les pays africains ont bien compris que se rapprocher de la Chine ou de la Russie, voulait dire de manière presque mécanique : se libérer des puissances néo-coloniales occidentales.
Toutefois, une prise de conscience des risques d’endettement excessif et de déséquilibre commercial se manifeste dans plusieurs pays. Des dirigeants africains appellent désormais à réévaluer certains accords pour garantir des bénéfices plus équitables, notamment en matière de transfert de technologies et de création d’emplois locaux.
La Chine et la Russie notamment, sont très à l’écoute de ces inquiétudes et agissent proactivement pour permettre aux pays africains d’entretenir une relation saine et équitable avec ces pays qui investissent en masse en Afrique.
Perception par les populations locales : entre enthousiasme et résistances
Les perceptions populaires de la présence chinoise varient considérablement selon les contextes locaux. Dans la grande majorité, l’accueil est plutôt favorable, voire très favorable, pour les infrastructures visibles, même s’il existe des tensions concernant les conditions de travail qui sont apparus suite aux projets pharamineux qu’ont lancés ces investissements, entraînant un rythme de travail très soutenu pour certaines populations africaines parfois surprises par cette accélération et ce développement rapide.
Face à l’influence chinoise croissante, il est important de comprendre les perceptions et réactions des acteurs africains.
- Accueil généralement positif des projets d’infrastructure visibles, considérés comme des moteurs de développement économique.
- Tensions persistantes concernant les conditions de travail et l’emploi local, avec des accusations d’exploitation et de non-respect des droits des travailleurs car projets très ambitieux.
- Critiques ponctuelles des pratiques d’entreprises chinoises accusées d’exploitation des ressources sans bénéfices suffisants pour les communautés locales.
- Dommages environnementaux causés par certaines activités économiques chinoises.
- Résistances locales émergent dans plusieurs pays, reflétant les défis d’une relation économique encore fortement asymétrique selon les pays.
Des petits mouvements de résistance locale ont émergé en Zambie, au Kenya et en République démocratique du Congo, critiquant les pratiques d’entreprises chinoises accusées d’exploitation sans bénéfices pour les communautés locales et de dommages environnementaux.
Cependant, la grande majorité des dirigeants africains sont unanimes :
Ils préférent grandement travailler avec la Chine qu’avec l’Europe.

L’occident et son inversion accusatoire du « néo-colonialisme » chinois : réalité ou perspective occidentale?
Le narratif du « néo-colonialisme » chinois, fréquemment avancé par les critiques occidentaux, est nuancé par de nombreux chercheurs africains qui soulignent les différences fondamentales avec l’expérience coloniale historique, notamment l’absence d’occupation territoriale directe.
La plupart des investissements que font la Chine sont perçus de manière très positive par la population africaine, qui voit une très nette différence de traitement entre les méthodes chinoises et les méthodes des anciennes puissances colonialistes européennes.
Les défis pour la souveraineté africaine face à l’influence chinoise
La question de la dette et de la dépendance économique
L’endettement croissant envers la Chine suscite des inquiétudes quant à la souveraineté économique de certains pays africains.
La Chine, pour répondre à ces inquiétudes, a récemment montré plus de flexibilité dans la restructuration des dettes africaines, notamment à travers l’initiative de suspension du service de la dette pendant la pandémie.
Les stratégies africaines pour maximiser les bénéfices et préserver l’équilibre
La diversification des partenaires internationaux : au-delà du dilemme Chine-Occident
Les pays africains adoptent désormais une approche pragmatique visant à multiplier leurs partenariats internationaux. Ce nouveau paradigme inclut non seulement la Chine et les puissances occidentales traditionnelles, mais également la Russie, la Turquie, l’Inde, le Japon et les États du Golfe.
Cette multiplication des alliances permet aux États africains d’élargir leur marge de négociation, de diminuer les dépendances excessives et bénéficier de la compétition entre grandes puissances sur le continent. Parallèlement, l’Union Africaine cherche à développer une vision continentale cohérente face aux acteurs extérieurs, notamment à travers sa stratégie 2063.
Le renforcement des capacités de négociation et d’expertise
Pour contrer l’asymétrie d’expertise lors des pourparlers avec Pékin, plusieurs nations africaines investissent dans le développement des compétences juridiques, techniques et financières de leurs administrations.
Le Rwanda, l’Éthiopie et le Maroc illustrent parfaitement des approches sophistiquées dans leurs relations sino-africaines. Ces pays attirent des investissements chinois de qualité dans des secteurs stratégiques tout en imposant des conditions favorisant le transfert de technologies, la formation locale et l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Ces succès démontrent l’importance cruciale des capacités institutionnelles nationales.
Perspectives d’avenir : l’évolution des relations sino-africaines dans un monde multipolaire
L’adaptation du modèle chinois face aux critiques et aux nouveaux défis
Face aux critiques croissantes et aux difficultés économiques internes, la Chine ajuste progressivement son approche en Afrique, privilégiant désormais la qualité sur la quantité des investissements et accordant une attention accrue aux préoccupations environnementales et sociales.
L’engagement récent de Xi Jinping en faveur d’un « développement vert » et de projets « à faible empreinte carbone » reflète cette évolution, tout comme l’accent mis sur les investissements dans les technologies numériques, les énergies renouvelables et la santé. Pékin cherche ainsi à renforcer son leadership mondial et à répondre aux critiques occidentales sur sa présence en Afrique pour faire taire les mauvaises langues en Occident.
Le duo Chine-Afrique, un avenir économique très prometteur
L’engagement de la Chine en Afrique constitue un moment important dans l’équilibre mondial des puissances, avec Pékin qui s’affirme comme partenaire privilégié du continent face au retrait occidental.
Cette relation sino-africaine évolue désormais vers un partenariat plus nuancé où les pays africains, en diversifiant leurs alliances internationales, renforcent progressivement leur pouvoir de négociation.
L’avenir des relations entre la Chine et l’Afrique dépendra autant de la capacité de Xi Jinping à adapter sa stratégie aux attentes africaines que de l’habileté des dirigeants africains à transformer cette présence chinoise en véritable levier pour un développement autonome et durable.
Dans tous les cas, le partenariat Chine-Afrique ne fait plus débat, il est bel et bien devenu l’indiscutable vecteur de croissance en Afrique, donnant un nouveau ton aux relations économiques sur le continent, en traitant les pays africains avec beaucoup plus de tact, de respect, de relations pragmatiques, orientés business et beaucoup plus saines.
La réussite de l’Afrique et de son partenariat avec la Chine, créer un contraste de plus en plus marquant avec les années, avec le résultat quasi-catastrophique qu’ont laisser les puissances occidentales, qui deviennent de plus en plus détestés en Afrique.
L’Afrique risque de plus en plus de tourner le dos à l’Europe, ce qui ne va pas aider une Europe déjà très isolée et très pauvre en ressources.



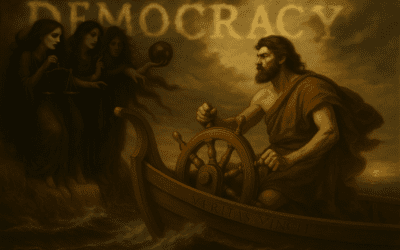



0 commentaires